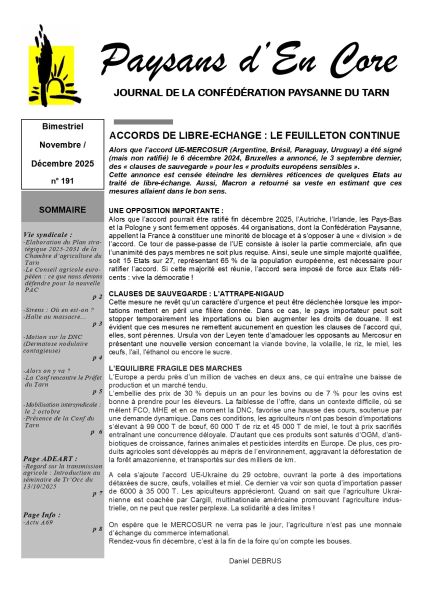Conférence Agro climatologie, à Brens, le 13/01/2025 face au changement climatique : "S'adapter ou disparaitre"?
Face au changement climatique : s'adapter…. Ou disparaître ?
Le lundi 13 janvier 2025 après-midi, environ 150 personnes s'étaient rendues, malgré le froid, dans le grand amphithéâtre de l'Inéopole-MFR* de Brens pour assister à cette conférence.
Nous avions prévu trois intervenants :
- Jean-Pierre Sarthou, professeur d'agronomie-agroécologie à l'Inp-Agro Toulouse et chercheur au CNRS*
- David Campo, directeur de l'association « arbres et paysages du Tarn »
- Cédric Cabrol : agroécoclimatologue étudie les interactions sol-végétation-climat.
- Les étudiants BPREA « maraîchage et paysans boulangers » ont assisté à la conférence et proposé une soupe de légumes bios à la fin.
Malgré l'absence physique de Jean-Pierre Sarthou, bloqué par un lumbago très tenace, nous avons pu profiter d'une introduction au sujet grâce à la projection du film de son intervention au colloque « mare nostrum », dans les Pyrénées orientales en juin 2024 :
- tout d'abord situation des différents types d'agricultures dans le monde et importance de chacune par rapport aux besoins alimentaires de la population mondiale. Globalement, c'est la petite agriculture paysanne qui nourrit le monde. L'agriculture industrielle alimente aussi les marchés mondiaux qui sont soumis à la spéculation. [Ndlr]
- problèmes causés pour la qualité des sols par un travail inadapté, souvent trop intense dans nos agricultures fortement mécanisées : perte d'humus entraînant une perte qualitative et quantitative de sol : érosion par ruissellement et par le vent.
- exemple de mise en place de haies dans une grande exploitation céréalière entraînant le retour de la biodiversité : plus d'insectes donc plus d'oiseaux, suppression des insecticides, moins d'intrants globalement.
Pour les participants à la conférence, déçus de son absence, Jean-Pierre Sarthou promet une nouvelle conférence à une date ultérieure.
David Campo a ensuite présenté les activités de l'association « Arbres et Paysages du Tarn ». Abordant dans un premier temps l'évolution encore préoccupante de la situation des haies en France : les plantations ne compensent pas encore les disparitions et les haies existantes sont souvent maltraitées : taille trop sévère rendant la haie inefficace pour l'hébergement d'insectes et autres auxiliaires des cultures et aussi pour la protection contre les vents.
Il a insisté sur la nécessité de « faire confiance au végétal », laisser la végétation se développer pour bénéficier de ses avantages. Priorité est donnée aux espèces autochtones : l'association recueille des graines dans la nature (parfois aidée par des bénévoles)) qu'elle confie à des pépiniéristes qui diffuseront les plants avec un souci de diversité des essences, Introduction aussi d'espèces nouvelles plus adaptées au changement climatique.
« Arbres et Paysages » peut aussi organiser des chantiers de plantation (participation d'élèves d'écoles, d'agriculture ou non). Elle assure aussi des formations auprès des agents d'entretien des bordures de route pour le respect des haies et la régénération naturelle.
La présentation de Cédric Cabrol de cette science nouvelle appelée agroécoclimatologie fut très dense, très riche et a quelquefois désorienté les auditeurs face à la multitude des diagrammes, concepts et photos de la végétation.
Essayons d'en retenir les principaux apports : tout d'abord le climat se réchauffe, c'est maintenant quasi-unanimement admis et l'action de l'homme en est responsable.
En agriculture bien que les principaux facteurs de libération de carbone habituellement mis en cause soient ceux des émissions de CO2 (des tracteurs et des sols), mais aussi de méthane (lié aux ruminants) ou dioxyde d'azote (lié aux engrais), un autre phénomène serait à prendre en compte: la dégradation des sols. Celle-ci s'accompagne souvent d'une perte d'humus qui alimente également l'atmosphère en CO2. Cependant, moins de matière organique c'est aussi moins de porosité du sol.
Or d'après la bibliographie climatologique l'humidité du sol influence fortement le climat, au travers de son relais : la plante
La présence de végétation joue un rôle à plusieurs niveaux :
Elle joue sur l'albédo (effet miroir / couleur du Tshirt)), donc renvoie de l'énergie dans l'atmosphère et évite ainsi un réchauffement trop important du sol
Elle crée par évapotranspiration une ambiance plus humide qui peut, si cette végétation est abondante, aller jusqu'à la formation de gouttes d'eau : elle peut provoquer de la pluie.
L'évaporation crée du froid (c'est le principe des réfrigérateurs) et facilite ainsi la condensation. En effet un air chaud sature beaucoup moins vite, il demande plus d'humidité pour arriver à la formation des gouttes d'eau. Les plantes peuvent provoquer un cercle vertueux : plus d'humidité du sol permet plus d'évaporation, qui rafraîchit, et permet qui permet la condensation, dans de nouvelles pluies.
La présence et la nature des nuages a aussi un effet :
Beaucoup d'humidité entraine la formation de nuages très gris et bas, ce qui freine l'action du soleil, d'où baisse de la température, condensation possible, et c'est parti pour la pluie.
Par contre si on a peu d'humidité, on a formation de nuages clairs, très hauts, qui vont jouer le rôle de couvercle et la température s'élève.
La présence de pollen dans l'atmosphère peut aussi avoir un impact sur la formation de gouttes d'eau.
Ainsi, mis bout à bout, cela fait dire à Cédric Cabrol “que lorsque l'on plante une plante on plante le climat qui va avec”. Les cultures provoquent un climat qui leur est favorable : Par exemple, la bibliographie démontre qu'au niveau de la du Corn Belt aux U.S.A. l'augmentation de la dispendieuse monoculture du maïs a entraîné une hausse des précipitations. (Ce qui ne veut pas dire que la monoculture est un exemple à suivre : elle pose d'autres problèmes -ndlr- ) (A l'inverse planter des cactus serait la meilleure façon de créer un désert. )
La bonne stratégie doit être offensive. Pour ce faire, il est nécessaire de retrouver des marges de manœuvres et c'est au niveau du sol que nous devons agir.
L'humus joue un rôle essentiel dans la fertilité du sol : à la fois rôle d'éponge pour retenir l'eau et structuration du sol pour préserver une bonne porosité et donc une bonne infiltration des eaux de pluie. L'utilisation d'images satellites qui observent l'activité photosynthétique permet ainsi d'établir des corrélations entre précipitations et taux de matière organique dans les sols : c'est frappant pour les cartes du Royaume Uni où on peut superposer la carte des précipitations annuelles et celle des taux d'humus. Sans surprise on peut aussi le vérifier avec la présence de forêts, de lacs, de certaines cultures.
De tout cela que peut retenir le paysan que nous sommes :
Il existe une multitude de facteurs favorables ou défavorables qui s'enchainent et s'amplifient les uns les autres (peut-on dire se catalysent ?), créant soit des cercles vicieux soit vertueux.
Nous pouvons améliorer notre environnement climatique en agissant à grande échelle :
- par notre action sur le sol : travail minimum, apport de matière organique, présence d'élevage… captation de rosée, et stockage de l'eau de pluie.
- par la présence de végétation abondante : prairies naturelles ou temporaires de longue durée, haies, agroforesterie, absence de sols nus, choix des cultures (le tournesol est plutôt une culture qui réchauffe : sa couleur est très sombre en fin de cycle)
Il est possible d'agir au niveau de la parcelle ou de l'exploitation (micro climat) et à grande échelle si nous sommes convaincus que c'est possible … et si la puissance publique nous aide (état, régions, départements…(ndlr).
Ndlr : note de la rédaction : ces remarques ont été ajoutées aux propos des intervenants.